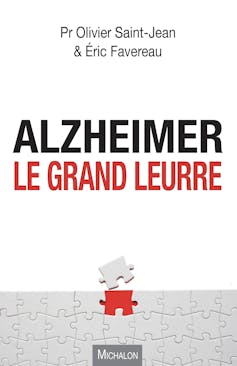La maladie d’Alzheimer ne va pas exploser, voici pourquoi

Notre auteur, professeur de gériatrie, dénonce dans son livre co-écrit avec le journaliste Éric Favereau, « Alzheimer le grand leurre » (Michalon), une médicalisation croissante de ce phénomène naturel qu’est le vieillissement. Selon lui, Alzheimer est une construction sociale bien plus qu’une réalité médicale. Et d’ailleurs, la grande épidémie annoncée ne se produira pas, affirme-t-il dans l’extrait que nous publions ci-dessous.
Une bonne nouvelle arrive, à contre-courant de toutes les prévisions : le nombre de cas supposés de la maladie d’Alzheimer diminue. Cette donnée peut surprendre, mais c’est ainsi.
Depuis 20 ans, on nous avait habitués à des prévisions catastrophiques ; on nous parlait d’épidémie mondiale de maladie d’Alzheimer ; on mettait en exergue le vieillissement inexorable de la population planétaire, en déduisant que les démences en tous genres ne pouvaient qu’exploser. Tout cela baignait dans un modèle médical expliquant scientifiquement, courbes à l’appui, ces évolutions dramatiques.
Ce n’est donc pas le cas. La maladie d’Alzheimer et les autres démences sont sur le déclin.
Ces deux dernières années, plusieurs études ont été publiées dans les plus grandes revues scientifiques, et toutes pointent la même tendance dans différents pays du monde : au cours des dernières décennies, il y a une diminution du nombre de nouveaux cas, ce qu’on nomme l’incidence.
Ces données sont issues, en particulier, de la fameuse cohorte américaine de Framingham, dévoilées dans le New England Journal of Medicine en 2016. À chaque décennie depuis les années 1980, les auteurs constatent une baisse moyenne de 20 % de l’incidence des démences. Ces constats ont été confirmés par les premiers résultats d’une autre étude menée aux États-Unis sur 20 000 personnes âgées de plus de 50 ans : entre 2000 et 2010, la prévalence de la démence chez les plus de 65 ans est passée de 11,7 à 9,2 %.
Une étude menée depuis 1948 dans une petite ville américaine
L’étude de Framingham fait en tout cas référence. Elle a été réalisée depuis 1948 dans cette petite ville du Massachusetts aux États-Unis, dont la population était somme toute très représentative ; en plus, la proximité de l’université de Harvard – l’une des institutions initiatrices du projet – permettait un travail efficace.
Commencée avec 5 209 personnes, l’étude en est désormais à sa troisième génération de participants. Cette enquête s’est d’abord penchée sur les principaux facteurs de risque des accidents cardio-vasculaires, montrant ainsi les méfaits de l’excès de cholestérol, de l’hypertension artérielle, du diabète, ou encore du tabagisme.
Depuis 40 ans, les participants font aussi l’objet d’examens de leurs fonctions cognitives. Les résultats publiés ont été obtenus à partir du suivi des volontaires de la première génération et de leurs descendants. Les chercheurs ont ainsi scruté l’apparition d’une maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence chez les plus de 60 ans, et cela pendant quatre périodes successives de cinq ans, allant de la fin des années 1970 à la fin des années 2010.
Une baisse de la proportion de personnes touchées
Le risque a été évalué à 3,6 % (taux d’individus) lors de la première période ; 2,8 % dans la deuxième ; 2,2 % durant la troisième ; et 2 % lors de la quatrième période. Soit une réduction moyenne de 20 % d’une décennie à l’autre.
Indéniablement, cela baisse. Qu’en déduire ? Est-ce que ce phénomène s’explique par la diminution des facteurs de risques vasculaires, ces pathologies pouvant provoquer des accidents cérébraux et donc, par ricochet, des démences ? Les auteurs répondent par la négative. D’autant que cette baisse est particulière : elle est statistiquement significative chez les personnes avec un niveau d’études au moins équivalent au bac.
Une autre cohorte, celle dite de Rotterdam, a montré une baisse, également de 20 %, des démences entre 1990 et 2000. Sur le plan statistique, ce n’était pas encore significatif mais une tendance comparable a été décrite au Danemark, puis au Royaume-Uni.
Pas d’épidémie monstrueuse d’Alzheimer
Bref, c’est un solide faisceau d’études qui l’indiquent. La fameuse chronique annoncée d’une épidémie monstrueuse de gens atteints d’Alzheimer se dégonfle, en tout cas en prévalence à un âge donné.
Et surtout, dans l’étude de Framingham, si l’évolution favorable du nombre de démences touche toutes les catégories d’âges, elle est spectaculaire chez les hommes, et particulièrement marquée dans les populations éduquées. L’élévation du niveau d’éducation pouvant, de ce fait, expliquer en partie le recul de l’âge moyen de début de la démence : 80 ans dans la première période, 85 dans la dernière.
Certains notent aussi que la baisse de l’incidence des maladies cardio-vasculaires, et donc des accidents vasculaires, cérébraux, qui contribuent aux démences, pourrait avoir des effets paradoxaux. « Dans chaque tranche d’âge, et en particulier dans les plus élevées, le recul des décès pour cause cardio-vasculaire exposerait davantage d’individus à une dégénérescence neuronale », a fait ainsi remarquer dans le quotidien suisse Le Temps le professeur Joël Ménard, professeur émérite de santé publique, qui a présidé en France le conseil scientifique de la Fondation Plan Alzheimer (2008-2012).
Lors de leur présentation des résultats de Framingham, les auteurs ont répondu que selon leurs calculs, « la baisse de la prévalence des démences compenserait dorénavant l’augmentation de l’espérance de vie, qui faisait mécaniquement augmenter le nombre de cas. Si bien qu’on devrait stabiliser le nombre global de cas. »
L’effet bénéfique du niveau intellectuel
De fait, cette évolution à la baisse renforce la piste selon laquelle Alzheimer n’est rien d’autre qu’une médicalisation du phénomène naturel de vieillissement cérébral. Bien plus que les autres, Alzheimer semble être une construction sociale qui s’est faite à un moment donné avec, derrière, la réalité clinique du vieillissement.
On devient vieux tard, et on le devient de plus en plus tard. Et dans cette évolution, la culture joue un rôle essentiel. Ce recul de la vieillesse résulte, bien sûr, des progrès médicaux classiques (les vieux sont mieux soignés), du mode de vie (cela va de soi), mais une éducation plus forte de toute la population mondiale favorise cette baisse.
Le niveau intellectuel repousse ainsi les frontières, comme si notre intelligence nous donnait des armes face à un processus dégénératif inscrit dans notre espèce.
Cela devrait nous rendre modeste sur l’importance ou la pertinence des politiques de santé. Si l’on remonte 30 années en arrière, nul n’aurait rêvé d’une telle action sur l’épidémiologie d’une maladie. L’ampleur est presque aussi importante que celle de la découverte des vaccins ou du traitement de la tuberculose !
À niveau égal de lésions dans le cerveau, on peut être normal… ou dément
À côté de cette découverte du poids de l’éducation et du niveau socio-éducatif, ce qui a peut-être le plus bouleversé nos connaissances scientifiques dans le domaine de l’Alzheimer, c’est la découverte de l’absence de parallélisme absolu entre les lésions anatomiques et les conséquences sur le fonctionnement cérébral. Alors que dans toutes les maladies existe le schéma classique qui associe symptômes et lésions, rien de cela dans l’Alzheimer.
Des études menées chez des religieux américains observent même qu’à niveau égal de lésions dans le cerveau, on peut être soit normal, soit dément. Étrange découverte, d’autant que ce qui semble expliquer cette différence est là encore le niveau social et éducatif.
Pour expliquer tous ces éléments, on a inventé le concept de réserve cognitive. Indiscutablement, ce concept est extrêmement séduisant même si aujourd’hui, et malgré tous les progrès en neurosciences ou en imagerie fonctionnelle cérébrale, personne n’a réussi à lui donner une base scientifique rigoureuse.
Pour autant, il est accepté par tout le monde, tant il explique cette épidémiologie si exceptionnelle et tant il ouvre des perspectives positives, aussi bien en prévention primaire qu’en accompagnement d’un déclin cognitif avéré. Les individus les plus stimulés intellectuellement arrivent ainsi à compenser plus longtemps une éventuelle altération de leurs fonctions cognitives sans manifester trop de symptômes.
En d’autres termes, comme tout organe, notre cerveau se dégrade mais deux processus contradictoires semblent en jeu : d’un côté, un vieillissement qui va vers une dégradation de nos capacités ; et de l’autre, des processus qui nous permettent de compenser, de mieux résister, et cela se fait par le biais de ce que l’on appelle la réserve cognitive.
La réserve cognitive, ou la capacité de riposte de notre cerveau
Que cache cette notion ? Des chercheurs comme des cliniciens estiment qu’il y a un domaine neuronal dont la fonction est de lutter contre la dégradation progressive de notre cerveau, en tout cas d’y trouver des réponses. Et cette capacité de riposte se renforcerait à tout âge de la vie.
Sans que cela constitue une preuve absolue, un certain nombre d’études observationnelles accréditent ce concept de réserve cognitive. On montre ainsi qu’exercer un métier à forte valeur de stress protégerait du déclin intellectuel, tout comme prendre une retraite tardive. Avoir une activité sociale riche et interactive avec le monde extérieur lors de la retraite serait aussi protecteur, y compris après 80 ans. Pratiquer une activité physique donnerait aussi des armes pour résister.
Ce concept de réserve cognitive expliquerait également la relation complexe entre prise de médicaments sédatifs comme les benzodiazépines et émergence du déclin cognitif ; ainsi selon les auteurs d’une étude franco-canadienne (Inserm et Université de Montréal) publiée en 2017, « les résultats renforcent l’idée d’un lien direct possible entre prise de benzodiazépines et la maladie d’Alzheimer ». Comme si ces médicaments paralysaient ou détruisaient un édifice patiemment construit.
Voilà qui éclaire également les très complexes relations entre pathologies psychiatriques et déclin cognitif. Toutes les maladies mentales exposent à un sur-risque de déclin cognitif, comme si elles empêchaient la construction ou l’utilisation de cette réserve.
|
|
Que dire de plus ? Cette résistance est un processus qui pourrait se bâtir tout au long de la vie. Elle est en même temps fragile car attaquée, déstabilisée par toutes les maladies que l’on peut contracter dans notre vie. Des chercheurs travaillent sur des liens entre le déclin cognitif et les maladies cardio-vasculaires, partant de l’hypothèse – qui n’est pas absurde – que si la personne est hypertendue, sa probabilité de subir un déclin cognitif avec l’âge serait plus élevée car elle aurait grignoté sa réserve cognitive.
Cette notion de réserve cognitive est, en tout cas, nouvelle. Et change les perspectives. Bon nombre de chercheurs y travaillent, essayant de mieux la définir, de la mesurer aussi, voire de la quantifier, ou de https://www.google.com/search?q=gateau+charentais&oq=gateau+charentais&aqs=chrome..69i57j0l5.6954j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8mettre en évidence quelques liens. Pour le moment, ce sont juste quelques pistes.
C’est un concept productif, établissant des passerelles entre le parcours de vie de la personne et le déclin cognitif qu’elle pourrait subir. La réserve cognitive ne serait pas seulement une faculté de s’adapter : elle devrait aussi s’entretenir, se développer. Ce qui ouvre des perspectives, en prévention comme pour la prise en charge.
Souce: the Conversation